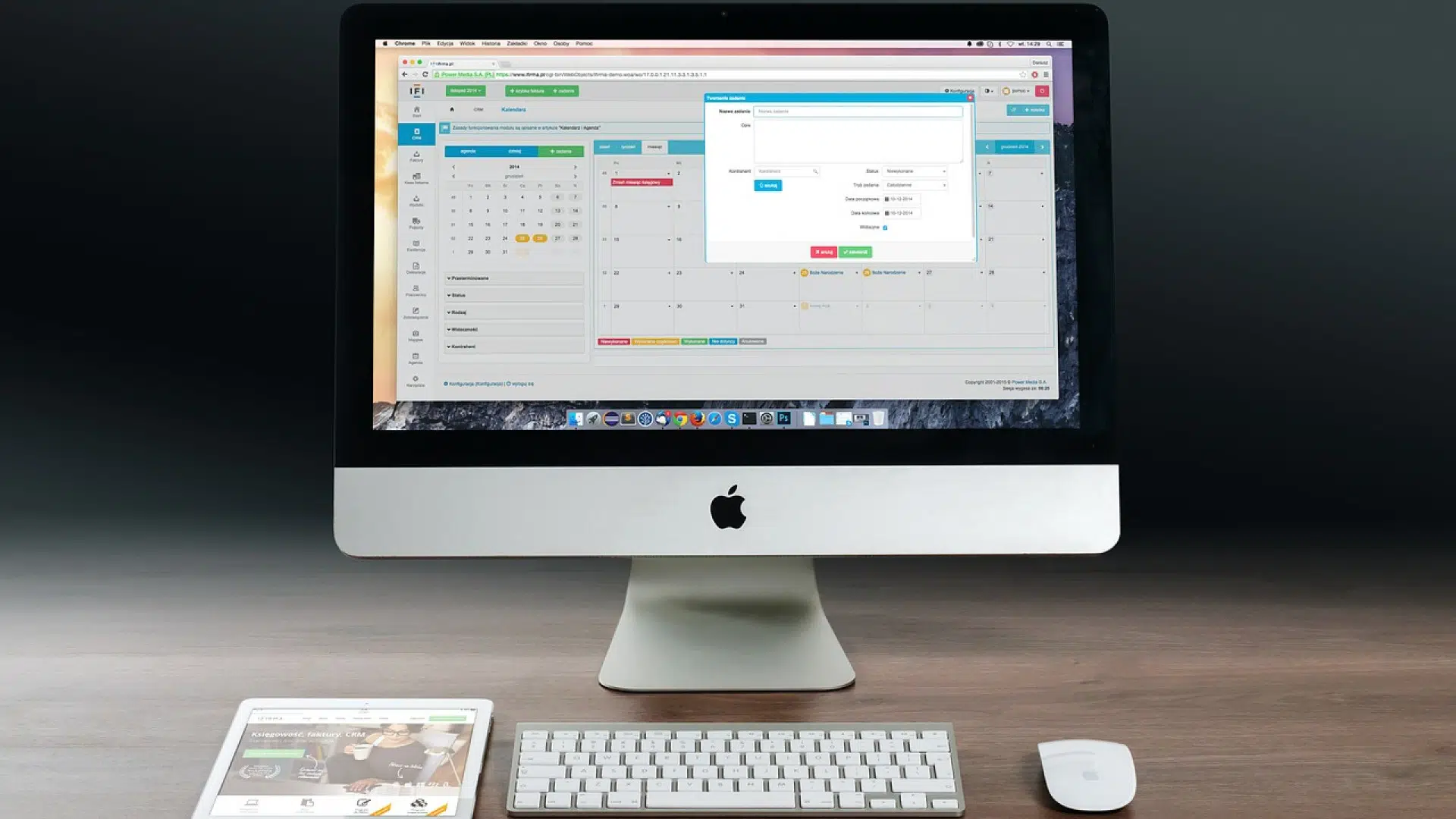2018 a signé la disparition du Régime Social des Indépendants tel que la France l’avait connu. Depuis, la protection sociale des travailleurs indépendants a basculé sous la houlette du régime général de la Sécurité sociale. Les fondations ont bougé, les démarches aussi. Auto-entrepreneurs, professions libérales, commerçants et artisans ont dû s’adapter à une nouvelle donne institutionnelle. Les déclarations, les prélèvements : tout, ou presque, a changé de circuit. Derrière le changement de nom, c’est toute l’organisation du suivi des droits, de la gestion des cotisations et du dialogue avec les organismes sociaux qui s’est transformée.
Le RSI, c’est fini : pourquoi ce changement de nom était inévitable
Le Régime Social des Indépendants (RSI) avait été lancé en 2006, censé simplifier la vie des artisans, commerçants et professions libérales. Mais la simplification n’aura pas tenu ses promesses. Problèmes de gestion, retards, dossiers égarés… Les critiques sont montées, année après année. La tension est devenue impossible à ignorer pour les pouvoirs publics. Le RSI n’a pas résisté à la pression populaire ni à la lassitude des affiliés.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a tranché net : le RSI, c’est fini au 1er janvier 2018. Nouvelle appellation : la Sécurité sociale des indépendants (SSI). Derrière ce changement, une volonté politique claire : en finir avec l’isolement, et intégrer les indépendants au régime général de la Sécurité sociale. Exit la gestion autonome, place au droit commun. Cette transformation, portée par le ministère des Finances et le gouvernement, s’est voulue progressive : SSI d’abord, puis fusion totale dans le régime général dès 2020.
Durant cette transition, les droits des assurés ont été préservés. Les démarches se sont alignées sur celles du régime général : interlocuteurs unifiés pour la maladie, la retraite, les cotisations. Le RSI a laissé la place à la SSI, elle-même absorbée dans la machine du régime général. Cette réforme ne se limite pas à un changement de façade : elle marque la fin d’une gestion à part, largement contestée, et l’intégration pleine et entière des indépendants dans la Sécurité sociale de droit commun.
Que devient la protection sociale des indépendants aujourd’hui ?
Depuis l’intégration de la SSI, la protection sociale des travailleurs indépendants s’articule autour du régime général. Les indépendants ne traitent plus avec un organisme à part, mais bénéficient d’un dispositif piloté par les grands acteurs de la Sécurité sociale. Pour chaque aspect de leur couverture, un organisme référent répond présent.
Voici comment se répartissent désormais les rôles :
- L’URSSAF prend en charge le recouvrement des cotisations sociales : toutes les démarches passent par elle, ce qui facilite le suivi et garantit la continuité du financement.
- La gestion de l’assurance maladie revient à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Les indépendants bénéficient ainsi de droits similaires à ceux des salariés pour les soins, la maternité, ou les arrêts de travail.
- Pour la retraite de base, la CARSAT prend la relève. Quant à la CIPAV, elle continue d’assurer la retraite complémentaire de certains professionnels libéraux.
Le CPSTI (Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants) joue le rôle de vigie : il veille à l’adaptation des dispositifs aux besoins des indépendants et fait remonter les situations particulières. Cette harmonisation ne gomme pas toutes les spécificités : les indépendants restent exclus de certains risques, comme les accidents du travail, les maladies professionnelles ou le chômage. Mais pour tout le reste, l’architecture reprend celle du salariat, adaptée à la diversité des statuts.
En pratique, les indépendants bénéficient donc d’un système plus lisible, d’interlocuteurs clairement désignés et d’une gestion simplifiée. Le cadre est plus homogène, même si certains enjeux restent propres aux travailleurs non-salariés.
Prélèvement à la source et auto-entrepreneurs : ce qui change concrètement
Le prélèvement à la source et la disparition de la Déclaration Sociale des Indépendants (DSI) ont profondément modifié la vie administrative des auto-entrepreneurs et des indépendants. La réforme a abouti à un guichet unique : la Déclaration Sociale et Fiscale Unifiée (DSFU), désormais le passage obligé pour tous les revenus professionnels non-salariés.
La DSFU se fond dans la déclaration annuelle de revenus : plus besoin de remplir deux formulaires distincts, et moins de risques de se tromper ou d’oublier une case. Les cotisations sociales des auto-entrepreneurs sont calculées automatiquement à partir des chiffres transmis à l’administration fiscale. L’URSSAF reste le point de contact unique pour le recouvrement, ce qui simplifie considérablement les échanges.
Pour ceux qui se lancent, la première année reste marquée par une estimation forfaitaire, ajustable dès que le chiffre d’affaires réel est connu. Les acomptes d’impôt peuvent être modulés à tout moment en fonction de l’activité, directement dans l’espace en ligne de l’administration. Les particularités du régime, franchise de TVA, exonérations en début d’activité, subsistent, mais la gestion opérationnelle gagne en cohérence et en visibilité.
Depuis 2023, même les professions libérales relèvent de la DSFU. Le résultat : un système plus transparent, qui articule la fiscalité et la protection sociale, et suit le calendrier du salariat. Pour les indépendants, c’est l’assurance d’une expérience administrative enfin alignée avec la logique du XXIe siècle.
Droits, démarches et obligations : ce que chaque indépendant doit savoir
Le passage du RSI à la Sécurité sociale des indépendants (SSI) n’a pas modifié le socle des droits : assurance maladie, maternité, retraite, invalidité-décès, allocations familiales restent garantis. Ce qui évolue, c’est la répartition des rôles : chaque organisme du régime général prend en charge sa mission, et l’URSSAF centralise plus que jamais le recouvrement des cotisations sociales.
Voici les points à retenir sur le fonctionnement de la protection sociale des indépendants :
- Le financement repose sur les cotisations, calculées à partir du revenu professionnel de chaque travailleur indépendant.
- La CSG et la CRDS viennent compléter ce prélèvement et alimentent la solidarité nationale.
- Pour ceux qui le souhaitent, le contrat Madelin permet de renforcer leur protection via des dispositifs de prévoyance ou d’épargne-retraite adaptés à leur statut.
La réforme a maintenu les taux de cotisation et les garanties sociales proches de celles du salariat. Certaines protections, l’accident du travail, la maladie professionnelle, le chômage, restent cependant hors de portée des indépendants. Le CPSTI intervient en cas de fragilité, avec des aides ponctuelles pour ceux qui traversent une mauvaise passe.
Une règle reste immuable : la vigilance lors de la déclaration annuelle. Toute erreur ou imprécision peut se traduire par une régularisation, parfois salée. La simplification n’efface pas la nécessité de rester attentif à la gestion de ses droits. Pour les indépendants, la réforme promet clarté et cohérence, mais le suivi reste un réflexe à cultiver.
Intégrés au régime général, les indépendants avancent désormais avec des repères mieux balisés. Mais derrière les sigles et les formulaires, une réalité demeure : la liberté d’entreprendre s’accompagne d’un devoir de lucidité administrative, pour ne rien laisser filer entre les mailles du filet social.