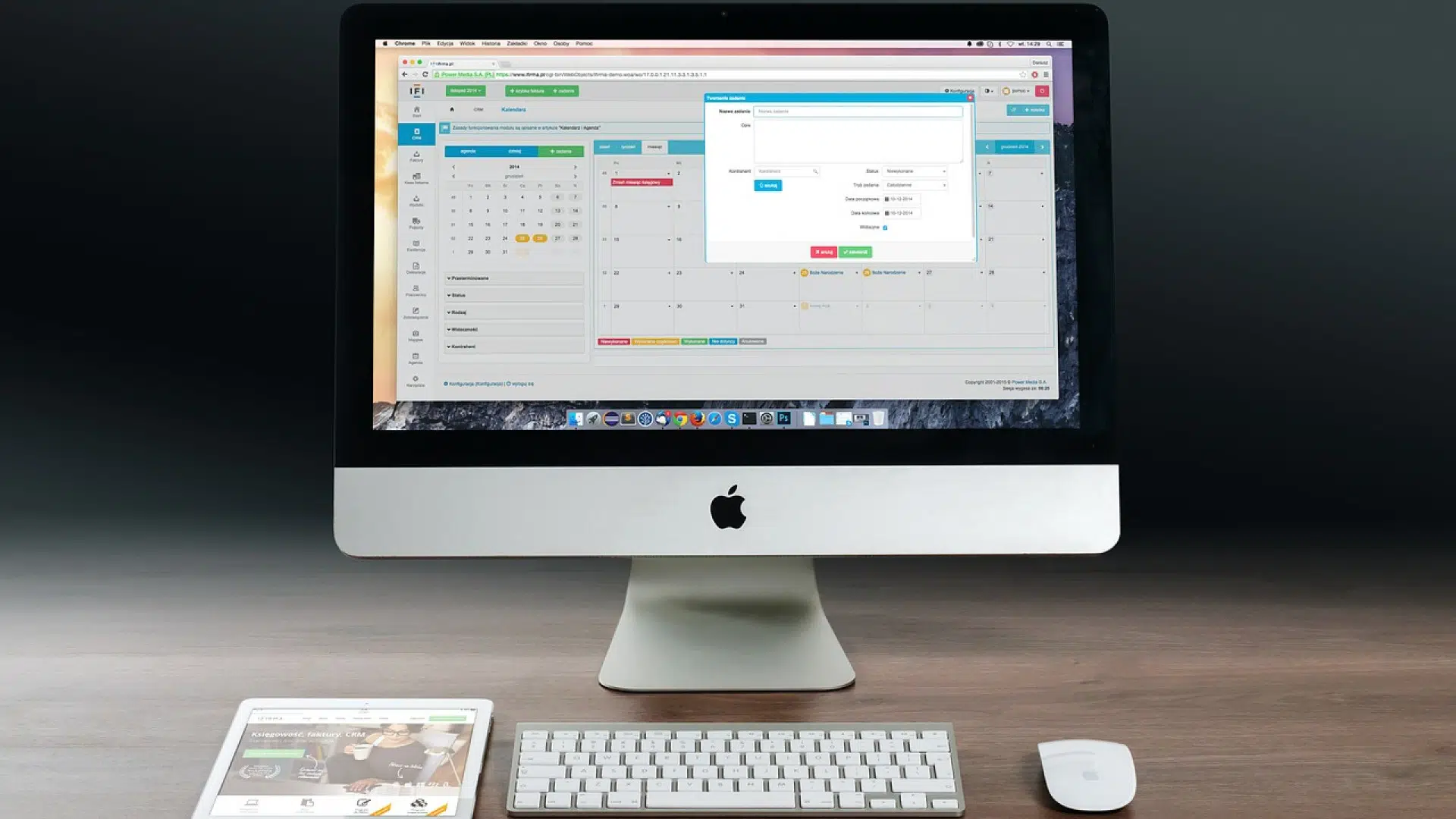600 000 professionnels, une convention qui gouverne chaque détail et, pourtant, une mosaïque de pratiques à travers le pays. La convention collective nationale du 15 mars 1966 encadre près de 600 000 salariés du secteur social et médico-social, mais ses règles de gestion salariale se distinguent par une hiérarchie de classifications unique et des mécanismes d’ancienneté spécifiques. Les modalités d’application varient sensiblement en fonction de la structure employeuse, générant des situations contrastées lors des revalorisations ou des négociations de branche.
Depuis plusieurs années, la perspective d’une fusion avec la convention collective 51 suscite de fortes interrogations, notamment sur la préservation des acquis et la portabilité des droits sociaux. Les employeurs doivent composer avec ces incertitudes tout en assurant la conformité de leur gestion des ressources humaines.
La convention collective 66 : un cadre de référence pour le secteur social et médico-social
Depuis près de soixante ans, la convention collective 66 (IDCC 413) façonne la structure sociale et les conditions de rémunération dans le secteur médico-social. Née d’un accord entre des organisations syndicales majeures comme Nexem, le SNASEA et la Fédération nationale de l’action sociale FO, elle s’impose auprès des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Les employeurs du secteur social, médico-social et éducatif l’appliquent pour encadrer leurs pratiques en matière de gestion du personnel.
Son champ d’action va bien au-delà de la seule question du salaire ou du temps de travail. Elle couvre les associations, fondations et structures qui accompagnent les publics fragiles. Elle définit des emplois-types, encadre la reconnaissance des qualifications et trace les parcours professionnels. Ce socle partagé garantit une certaine cohérence nationale, là où les besoins réels varient fortement d’un établissement à l’autre.
Le dialogue social, clé de voûte du dispositif, permet de faire évoluer régulièrement le texte. Grâce à la présence active des syndicats, les adaptations collent au terrain et la convention s’impose souvent face au simple code du travail. Pour les employeurs comme pour les salariés, elle reste un pilier fondamental qui structure les relations de travail et balise les conditions d’exercice des métiers sociaux et médico-sociaux.
Quelles protections et avantages pour les salariés concernés ?
La convention collective 66 offre aux salariés du secteur un ensemble de garanties qui structurent leur quotidien professionnel, qu’ils soient cadres ou non-cadres. Les grilles salariales reposent sur une valeur du point et des coefficients précis, assurant une progression claire selon l’expérience acquise et le niveau de qualification.
Voici les principaux congés et avantages accordés :
- Congés payés : acquisition de 2,5 jours chaque mois, soit 30 jours ouvrables par an.
- Congés d’ancienneté : 2 jours ajoutés tous les cinq ans pour récompenser la fidélité.
- Congés exceptionnels : prévus lors d’événements familiaux, ils tiennent compte de la vie personnelle des salariés.
- Congés trimestriels : une spécificité de la convention, qui s’ajoute au cadre légal.
Le système de primes complète le dispositif : la prime d’ancienneté et la prime de sujétion spéciale (8,21 % du salaire brut indiciaire) valorisent l’implication sur le terrain. Le congé maternité, lui, prévoit une réduction de 10 % du temps de travail à partir du troisième mois de grossesse, sans impact sur la rémunération, et un maintien total du salaire net dès lors qu’une année d’ancienneté est atteinte.
Le maintien de la rémunération en cas d’arrêt maladie constitue un autre axe fort : trois mois à plein traitement pour les non-cadres, six pour les cadres, puis 50 % sur la même durée. La prévoyance intervient en cas d’invalidité ou de décès, sécurisant ainsi le parcours professionnel en cas de coup dur. Enfin, la formation continue s’inscrit dans les garanties de la convention, favorisant l’adaptation aux évolutions constantes du secteur et la valorisation des compétences.
Gestion salariale : points clés et obligations spécifiques à connaître
Pour une entreprise sociale ou médico-sociale relevant de la convention collective 66, la gestion salariale implique de naviguer avec précision dans un cadre exigeant. La grille salariale, basée sur les coefficients liés à la qualification et à l’ancienneté, ainsi qu’une valeur du point (3,93 euros selon Nexem, 3,82 euros ailleurs), structure l’ensemble des rémunérations. Chaque évolution de la valeur du point se répercute sur tous les traitements, imposant une vigilance continue.
La convention encadre aussi le temps de travail, notamment la durée maximale de travail de nuit limitée à 10 heures, jusqu’à 12 heures dans des conditions spécifiques. Cette règle vise à protéger la santé des équipes tout en tenant compte des besoins des établissements.
Voici les obligations majeures à respecter :
- Respect de la grille salariale selon le niveau de qualification et l’ancienneté
- Application stricte de la valeur du point
- Intégration des primes conventionnelles (ancienneté, sujétion spéciale)
- Contrôle du temps de travail, avec vigilance sur les horaires de nuit
La gestion de la masse salariale requiert donc une connaissance fine du texte, mais aussi un suivi des pratiques du secteur. Les négociations, notamment sur la valeur du point ou les conditions de travail, rythment la vie des établissements. Nexem et les partenaires sociaux veillent à l’application correcte des règles. Pour l’employeur, rigueur et transparence s’imposent à chaque étape.
Fusion avec la convention collective 51 : quels enjeux pour les employeurs et les salariés ?
La fusion des conventions collectives 66 et 51 bouleverse la donne dans le secteur médico-social. L’objectif d’harmonisation des droits et avantages sociaux mobilise syndicats et employeurs autour d’une refonte en profondeur. La convention 66, centrée sur l’action sociale, dialogue désormais avec la convention 51, historiquement ancrée dans la Croix-Rouge française. Chacune porte des valeurs et des habitudes de gestion différentes.
Côté employeurs, le rapprochement impose de revoir la gestion des ressources humaines dans le détail. Il s’agit d’aligner les grilles salariales, de clarifier les systèmes de primes et de rendre les statuts plus lisibles. Mais les différences subsistent : la prime de sujétion spéciale ou la prise en charge des arrêts maladie, par exemple, ne se recoupent pas parfaitement. Adapter les outils de paie, anticiper les coûts induits, sécuriser les parcours : à chaque étape, de nouveaux défis surgissent.
Pour les salariés, cette période est source d’attentes mais aussi de doutes. L’alignement des droits pourrait se traduire par des avancées, mais il n’est pas exempt de remises en question. Les représentants du personnel s’efforcent de défendre les acquis, tout en visant une plus grande équité entre tous. Au-delà du salaire, l’enjeu touche à la reconnaissance, à la mobilité interne, à la valorisation des carrières et à l’attractivité globale des métiers du sanitaire et social.
Les négociations se poursuivent entre les acteurs de la convention collective 66, de la convention collective 51 et les institutions. Les décisions à venir dessineront le futur du secteur, avec la promesse d’un cadre plus lisible, et la certitude que l’exigence collective ne fera que grandir.